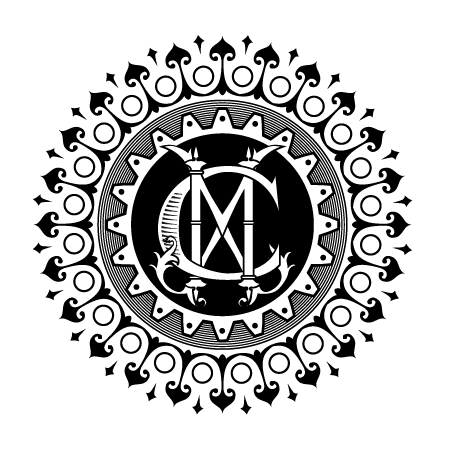Malgré le NaNoWriMo toujours en cours et une semaine qui voit déjà la publication d’une autre de mes nouvelles Les petits enfants dans le Labos des Éditions Walrus, je suis toujours à fond (normalement).
Cette semaine, c’était une phrase de Vincent B. choisie par ma co-marathonienne.
 « La deuxième bouteille est tombée. Les tensions baissent, les voix montent. Ça commence à être intéressant. »
« La deuxième bouteille est tombée. Les tensions baissent, les voix montent. Ça commence à être intéressant. »
Skörn venait de faire son rapport à sa mère et retournait à son poste. De l’extérieur, la lumière vacillante des centaines de bougies faisait danser les ombres des quatre hommes à travers les carreaux. La neige était haute. Skörn était collé à une fenêtre. Il regardait ces gens si redoutés occupés à lever leur verre pour passer une soirée de détente paisible.
Freyja rappela l’enfant et lui intima l’ordre de revenir à la maison. Elle chuchotait, de peur de se faire entendre. Après tout, les guerriers qui buvaient à la taverne étaient les quatre pires bandits du pays. Ils avaient ravagé nombre de bourgades, pillé autant de maisons et tué un à un leurs occupants. Pourquoi avaient-ils décidé d’épargner ce village et ses habitants étaient encore un mystère, mais la jeune mère ne voulait pas risquer davantage de réveiller leur colère en laissant son fils de cinq ans jouer les espions à travers la fenêtre.
« Alors que font-ils ? demanda Ragnar, le mari de Freyja, quand celle-ci entra dans leur maison en traînant Skörn par la main.
— Ils boivent. Que veux-tu qu’ils fassent ? Quant à toi, petit homme, ajouta-t-elle à l’intention de son fils, tu vas te coucher immédiatement ! »
Ragnar était inquiet, comme l’était chaque personne du village. Il fallait agir. Ces quatre bandits allaient mettre le village à feu et à sang s’ils les laissaient faire. Pourtant, personne n’avait eu le courage de les arrêter ni de les empêcher d’entrer dans la taverne à leur arrivée. Quand il pensait à Hilda, sa nièce, toute seule avec ces brutes, parce que son père était parti trois jours à la ville pour le marché… Il ne pouvait que s’inquiéter pour elle et le risque qu’elle courait en étant en première ligne.
Freyja revint de la chambre où elle venait de border Skörn.
« Qu’est-ce que tu as en tête ? » lui demanda-t-elle.
Elle le connaissait bien et voyait quand il préparait quelque chose qui était soit idiot, soit dangereux, souvent les deux en même temps.
« Je ne peux pas laisser Hilda seule plus longtemps avec ces bandits. Ils ont pillé et décimé des dizaines de villages, imagine ce que risque ma nièce…
— Et le reste du village ! ajouta Freyja. Qu’est-ce que tu comptes faire ? Tu n’es qu’un bûcheron. Ce sont des combattants aguerris. Et ils sont quatre.
— Il faut que j’arrive à rassembler les hommes du village. À nous tous, nous devrions pouvoir les forcer à partir.
— Pour qu’ils reviennent dans plusieurs jours, de nuit, et mettent le feu à toutes les maisons pendant que tout le monde dort ? Tu n’y penses pas !
— Tu préfères que nous les laissions faire ? Je sais que c’est dangereux, mais si nous n’agissons pas, nous risquons gros, très gros. »
Freyja se rembrunit. Il n’y avait pas beaucoup de solutions pour se débarrasser de ces dangereux intrus, pourtant les attaquer de front, même en grand nombre, risquait de coûter la vie à quelques-uns des hommes du village, voire tous. Et Freyja ne pouvait pas accepter que quiconque meure de cette manière.
« Je vais m’en occuper, dit-elle simplement.
— Qu’est-ce que tu as l’intention de faire ?
— Je ne sais pas encore. Je vais voir avec mes sœurs et les autres femmes. Je suis sûre que nous trouverons une solution. »
Ragnar soupira. Il ne voulait pas laisser sa femme se jeter dans les griffes de ces tueurs sanguinaires dont la réputation les précédait de si loin, pourtant il n’avait pas vraiment le choix. Il savait que son épouse ne l’empêcherait d’aller se battre sans avoir testé, elle, une solution plus subtile.
Freyja embrassa son mari, qu’elle sentit crispé. Elle savait qu’il s’inquiétait déjà mais il fallait qu’elle fasse quelque chose.
La jeune femme alla frapper à la porte de sa grande sœur, Helena. Quand elle lui ouvrit, Freyja vit que Kirsten, une autre de ses sœurs, était là aussi.
« Je suis contente de vous trouver ensemble.
— Ulrik est parti avec Ørjan pour réunir les hommes du village. Ils veulent agir contre les bandits. Mais même s’ils sont à vingt contre quatre, j’ai peur qu’ils n’y arrivent pas. On dit que ce sont des fils de Dieux qui ont été bannis du Valhalla. C’est pour se venger de leurs parents qu’ils mettent le monde à feu et à sang.
— Ne dis pas n’importe quoi, Kirsten, coupa Freyja. Ce sont des bandits, c’est tout. Mais si nos hommes y vont, ils risquent de ne pas en revenir. Et si ce ne sont pas nos maris qui mourront ce soir, ce seront ceux nos amies. Il est hors de question de laisser faire cela. Je le refuse.
— À quoi penses-tu, alors ? »
Freyja sourit avec cet air espiègle que ses sœurs lui connaissaient bien.
Vingt minutes plus tard, neuf femmes du village marchaient dans la neige tassée vers la porte de la taverne. Freyja avait réussi à convaincre ses amies de la suivre dans son plan fou.
La porte de la taverne s’ouvrit et d’un coup le silence se fit. Les quatre bandits fixaient l’entrée, le regard prêt à foudroyer les intrus qui gâchaient la fête. Il y avait déjà huit cadavres de bouteilles sur la table et peut-être d’autres au sol. Quand les quatre virent que les importuns n’étaient en fait que des femmes, leurs fronts se détendirent et leurs sourires s’étirèrent. Les hommes du village étaient-ils si lâches qu’ils envoyaient leurs épouses comme offrandes pour les épargner de leur colère ? Ou peut-être bien ces femmes venaient-elles d’elles-mêmes pour goûter à autre chose qu’à de mous bûcherons ou pêcheurs. Ils n’en savaient rien et s’en fichaient. Les quatre bandits ne voyaient que le bon temps qu’ils allaient prendre avec des belles donzelles.
« Hé là ! Mignonne ! Ramène-nous donc encore quelques bouteilles que nous puissions partager avec les nouvelles clientes. Et vous, mes chéries, venez donc vous asseoir près de nous pour nous réchauffer. C’est vrai qu’il fait froid dans votre contrée ; à tel point que le feu et l’alcool ne suffisent pas ! Venez ! Venez ! Approchez-vous »
Freyja entra la première et s’approcha de celui qui avait parlé, le chef, vraisemblablement. Elle se forçait à soutenir le regard du bandit, se concentrant pour ne pas trembler de peur, se demandant ce qu’il lui avait pris de faire une chose pareille. Il y eut un moment de flottement dans les rangs composés de ses sœurs et amies, mais celles-ci entrèrent enfin en voyant Freyja au milieu de la pièce, seule, à quelques pas des crapules. Aucune d’elles ne pouvait la laisser ainsi avec quatre des pires hommes du continent.
Hilda arriva avec de nouvelles bouteilles. Elle blêmit en voyant que presque toutes les femmes du village de moins de quarante ans étaient là. Étaient-elles devenues folles ? Elle ne savait pas comment elle avait pu rester en vie jusqu’ici ni même avoir reçu de main aux fesses ou pire. Pourquoi donc les autres venaient ici ? C’était comme si des poules étaient allées de leur plein gré dans le terrier du renard.
« Est-ce que tu peux nous apporter des gobelets aussi, Hilda, je te prie ? » demanda Freyja le plus posément qu’elle put.
Sa voix chevrotait quelque peu, mais personne n’avait semblé s’en rendre compte.
Hilda acquiesça à la demande de sa tante par alliance et repartit derrière son comptoir après avoir posé quatre nouvelles bouteilles sur la table. Toutes les femmes étaient déjà assises de manière à ce que chaque bandit fût entouré de deux d’entre elles.
Un étrange silence se fit. Hilda en fut étonnée car, depuis que ces rustres étaient entrés dans son commerce, ils n’avaient pas arrêté de discuter, de débattre, de s’engueuler, de rire trop fort, mais jamais le silence n’avait duré plus qu’un claquement de doigts. Elle s’empressa d’amener les gobelets de peur que l’absence de bruit ne déclenche la colère des indésirables invités.
Aussitôt posés sur la table, les gobelets furent remplis jusqu’à ras bord et les discussions reprirent. La serveuse n’en revint pas du changement. Les bandits ne hurlaient plus, ils parlaient, certes fort, mais de manière beaucoup plus modérée que jusque-là.
« Que venez-vous faire par ici, mes jolies ? demandait l’un.
— Vous cherchez la compagnie de vrais hommes ? demandait un autre.
— C’est très plaisant de pouvoir se détendre avec d’autres que ces trois-là, disait un troisième. Ils ne parlent que de la même chose et se battent toujours pour savoir lequel a raison, alors que c’est moi. C’est toujours moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis le plus intelligent des trois. »
Le quatrième commença à élever la voix pour contredire ce troisième si prétentieux, mais une des femmes qui l’entouraient, voyant le danger venir, réussit à le faire changer de sujet et il oublia cette querelle débutante.
Les conversations allèrent bon train. Les brutes s’étaient adoucies et cherchaient à passer pour de gentils garçons face à ces jolies femmes venues d’elles-mêmes à leur rencontre. Hilda n’en revenait pas.
Les bouteilles continuaient de se vider. La serveuse allait bientôt manquer de stock. Elle n’espérait même pas être payée et se demandait s’il valait mieux être ruinée ou morte.
Soudain, alors qu’elle descendait à la cave pour la neuvième ou dixième fois — elle ne savait plus —, elle entendit du fracas dans la salle. Elle remonta précipitamment l’escalier et sursauta presque en voyant les quatre seuls hommes de la taverne affalés sur la table. Les femmes se relevaient en soupirant fort de soulagement.
« J’ai cru qu’on n’y arriverait jamais ! lança Helena.
— Moi non plus ! répondit Freyja. Ils sont vraiment coriaces !
— Qu’est-ce qu’il s’est passé ? demanda Hilda, abasourdie.
— Les remèdes de Grand-Mère Ingrid font toujours des miracles, répondit Freyja. Pendant que l’une de nous occupait son bandit, l’autre versait de la décoction spéciale insomnie dans les gobelets de ces idiots… Kirsten, va chercher nos hommes. C’est à eux d’agir maintenant que le plus dur a été fait. Hilda, tu as de la corde ou quelque chose comme ça, pour qu’on les attache d’ici là ? Ce sont des forces de la nature, je ne sais pas combien de temps l’effet de la potion durera. »
La serveuse redescendit à la cave et en remonta bientôt avec suffisamment de corde pour lier pieds et poings de chaque bandit. Pendant ce temps, les autres avaient décroché les ceinturons portant les armes des brutes. Elles les avaient également fouillés pour s’assurer qu’ils ne cachaient pas sur eux une dague ou quelque chose qui aurait pu les aider à s’enfuir, voire pire. Elles en profitèrent pour récupérer leurs bourses, heureusement fort bien garnies. Il fallait bien payer tout ce qu’ils avaient consommé ici.
Quand les hommes du village arrivèrent, ils n’eurent rien d’autre à faire que de porter les bandits profondément assoupis pour les sortir de la taverne et les déposer chacun contre un sapin. Ils y furent attachés jusqu’à ce que leur sort soit arrêté.
Les hommes tergiversaient. Les uns voulaient les décapiter tout de suite puis enterrer les corps loin dans la forêt, les autres, trop effrayés à l’idée de voir les fantômes de ces monstres les hanter, préféraient les remettre aux autorités contre des primes si leurs têtes étaient mises à prix, mais les premiers avaient peur à l’idée que ces bandits soient un jour libérés et reviennent se venger. La discussion, dont le ton montait petit à petit, tournait en rond.
Freyja s’énerva de ne voir aucune décision prise et, d’un éclat de voix qui résonna dans le village, ramena le silence.
« Helena, Kirsten et moi allons trouver les autorités pour qu’elles viennent avec un juge et un bourreau. L’exécution se fera dans les règles pour que personne ne puisse rien nous reprocher. En attendant, les hommes auront pour mission de surveiller ces marauds ! Dès qu’ils se réveilleront, il leur sera de nouveau administré une décoction de Grand-Mère Ingrid, afin qu’ils n’embobinent personne en promettant monts et merveilles ou en faisant peur avec des menaces de représailles. Est-ce bien clair ?
Le silence de la nuit répondit à sa question.
— Je prends ça pour un oui, donc maintenant, les hommes, débrouillez-vous avec les tours de garde. Il faut toujours deux d’entre vous au minimum. Nous les femmes, nous avons suffisamment donné de notre personne, ce soir. Rentrons dans nos foyers pour nous reposer. »
Freyja avait beau être jeune, elle donnait des ordres comme un chef militaire aguerri. Les hommes restèrent dehors, près des bandits attachés, à se regarder, penauds.
* * *
Deux jours plus tard, Freyja revenait de la ville avec ses sœurs et, comme elle l’avait annoncé, avec un juge et un bourreau. Il n’avait pas fallu beaucoup pour les convaincre de venir voir ces grands bandits, tristement célèbres dans tout le pays. Ils avaient même détaché dix soldats, au cas où la peine de mort n’aurait pas été prononcée et qu’il aurait fallu ramener quatre prisonniers à la ville.
L’équipée arriva au village en milieu d’après-midi. Le soleil n’était déjà plus très haut dans le ciel complètement dégagé. Le vacarme des chevaux rameuta les villageois. Tous savaient ce que cela signifiait : ils allaient enfin être débarrassés de ces quatre dangereux bandits sanguinaires.
Le juge, qui menait le cortège avec Freyja, sauta au bas de son cheval, imité par le bourreau. Toujours montés, les gardes manœuvrèrent pour encercler les prisonniers. Ceux-là n’avaient pas bougé d’un pouce à tel point qu’ils s’étaient déféqués et urinés dessus. Ils sommeillaient toujours.
Le juge s’approcha, mais pas trop près. Même endormis, ces bandits pouvaient être dangereux. Il se tourna vers le chef des gardes et lui fit signe de venir à lui. Celui-ci s’exécuta. Le magistrat se pencha vers lui et chuchota au creux de son oreille. Freyja et le reste du village brûlaient de savoir ce qu’ils se disaient.
Au bout de cinq minutes de palabres, le juge se tourna vers celle qui l’avait mandé. Il avait l’air très gêné.
« Que se passe-t-il, monsieur le juge ? s’enquit Freyja.
— Je crains de ne pouvoir juger ces personnes, madame !
— Pourquoi donc ?
Le juge inspira profondément, se racla la gorge et lâcha enfin :
— Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais il est clair que ce ne sont pas les bandits que nous recherchons. »
Par ici pour le texte de Miki.