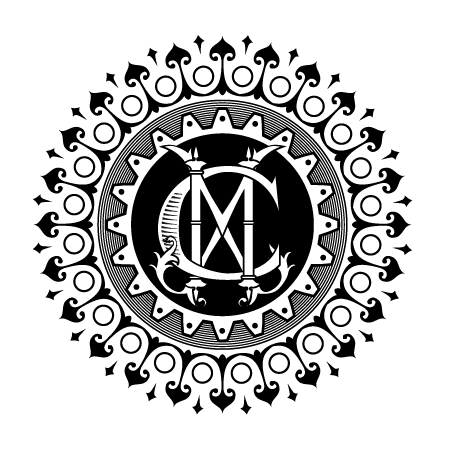Il y a quelques jours, j’ai lu un article qui m’a quelque peu remué. Non, je ne me suis pas mis à pleurer à cause d’un spoil sur Game of Throne. J’ai lu la découverte récente de chercheurs et je me suis mis à extrapoler fort, me disant que la réalité rattrapait la fiction.
Cet article, c’est celui-ci : http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/biologie-apprendre-vite-notre-cerveau-synchronise-ondes-cerebrales-54145/
Pour celles et ceux qui ont la flemme de cliquer (vous avez tort, c’est un article assez court et pas trop technique), en gros, ça raconte que, quand on apprend quelque chose, les différentes parties du cerveau se synchronisent pour communiquer plus rapidement, avant de créer les liens synaptiques qui « figent » en mémoire les notions nouvellement acquises.
Jusque-là, c’est une jolie découverte mais pas de quoi s’exciter, vous allez me dire.
Sauf que si on y pense, cette découverte ouvre la voie du plausible pour plein de rêve de science fiction et autre fantasy. Je m’explique.
Déjà, partons du postulat de base (j’adore cette expression ^^), que nos amis scientifiques n’ont pas encore tous les outils pour mesurer le spectre complet d’ondes de notre cerveau (parce qu’on en découvre encore tous les jours, donc il n’y a pas de raison que sur ce point, nous ayons tout vu).
Pourquoi le cerveau arriverait-il à se synchroniser avec lui-même et pas avec celui du voisin ?
Je prendrai d’abord l’exemple des jumeaux. Il paraît que les jumeaux sont « connectés » et qu’ils arrivent à ressentir l’autre même à des milliers de kilomètres.
1 — La théorie des Jumeaux
Tout le monde rêve d’avoir des jumeaux, sauf les parents de jumeaux 😉
Dans cet article assez long sur les jumeaux et surtout ceux séparés à la naissance, il est écrit :
Sur un électroencéphalogramme, les ondes cérébrales des vrais jumeaux sont même plus semblables que nos études l’auraient laissé supposer.
On a effectivement démontré en Union soviétique qu’en anesthésiant chimiquement un jumeau, l’autre éprouvait les effets du sommeil artificiel.
Si l’on pince un jumeau jusqu’au sang, une tache rouge apparaît sur le bras de l’autre.
S’il y avait dès la maturation in utero une synchronisation cérébrale entre les fœtus ? Une synchronisation si forte que même en étant séparés dès leur plus jeune âge, le lien entre les deux individus perdurerait ?
Évidemment, le code génétique doit entrer en jeu pour permettre une facilité dans cette synchronisation externe mais ne vous est-il jamais arrivé de vous dire « tiens, il faut que j’appelle ma mère, ma/mon chéri(e), ma meilleur copine, etc. et que votre téléphone sonne à cet exact instant d’un appel de cette personne ?
2 — La personne que j’essaye d’appeler m’appelle
C’est quand même dingue le hasard !
Quand j’étais jeune, au millénaire précédent, je traînais souvent tout le temps avec deux copains. Les inséparables, pourrait-on dire. Et souvent, il nous arrivait de penser exactement la même chose au même moment, sans avoir ouvert la bouche ou alors, l’un commençait une phrase, le second la continuait et le troisième la terminait. Et la phrase était exactement celle que chacun aurait dite individuellement.
Étions-nous synchronisés cérébralement parlant ? (oui, bon, je ne sais pas si parler de cerveau et d’adolescents mâles, ça marche vraiment 🙂 )
À présent, c’est avec ma chérie que ça m’arrive. Je me dis que je vais lui envoyer un message pour lui dire bonjour et paf, j’en reçois un de sa part. L’inverse arrive aussi assez régulièrement.
L’amour serait-il aussi une question de synchro ? (pas que, évidemment).
Mais si on arrive à penser l’un à l’autre au même moment parce qu’on est un peu connectés sans s’en rendre compte, qu’est-ce qui nous empêcherait de communiquer à distance ?
3 — La télépathie
Un peu de SF, parce que c’est la classe !
Si deux personnes sont synchronisées, peut-être peuvent-elles communiquer ensemble ?
Attention, je ne dis pas « parler » mais bien communiquer, c’est-à-dire, faire partager des ressentis, des sentiments, des « images ». Je pense que la seconde citation de ce billet permet un élément de réponse même si on n’arrive pas encore à l’expliquer.
On pourrait même imaginer qu’avec un peu d’entraînement, chacun pourrait changer (plus ou moins) facilement de fréquence de « travail » et communiquer avec plusieurs personnes (mais pas forcément en même temps).
4 — Les dangers de notre monde actuel
Oui parce qu’il faut bien un peu d’alarmisme, sinon c’est pas drôle.
Les ondes cérébrales sont bien des ondes, au moins en partie connues puisque mesurables. Certaines personnes se plaignent de toutes celles qui nous servent au quotidien pour notre confort moderne (réseau GSM, Wifi, etc.) : les gens atteints d’électrosensibilité.
Certains, moins « sensibles », se plaignent juste de maux de tête et de problèmes de sommeil quand ils se trouvent dans des endroits à haute densité de rayonnement Wifi.
Loin de moi l’idée de jouer les anti-ondes et surtout les anti-modernité (Je mourrais sans internet ^^) mais je me pose la question sur ces personnes électrosensibles. S’ils arrivent à ressentir la puissance des ondes qui nous entourent, c’est que celles-ci ont bel et bien un impact sur nous, même bénins pour la plupart.
Quel est l’impact réel de ces rayonnements GSM ou Wifi sur les capacités de notre cerveau à synchroniser ses parties internes ? Ces ondes, si elles permettent une communication rapide vers des interlocuteurs lointains ou un accès à quasiment tout le savoir du monde, n’empêchent-elles pas d’utiliser d’autres fonctions de notre cerveau que nous ne connaissons qu’à peine ?
Ne ralentissent-elles pas notre évolution vers un meilleur niveau d’utilisation de notre cerveau ?
Évidemment, ce billet n’est absolument pas scientifique (ni philosophique). C’est juste un début de réflexion sur le possible, sur le plausible et sur ce qu’on peut faire de ce qui se trouve entre nos oreilles.
Et c’est aussi un petit brainstorm qui peut toujours débuter sur des idées de romans, mais chut.