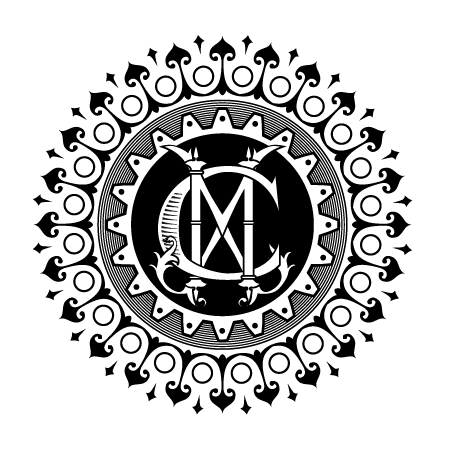1189 mots
Le raisonnement derrière cette décision semble solide.
Pourtant, j’ai l’impression de faire une connerie.
Mais l’ordinateur de bord ne se trompe jamais, n’est-ce pas ? Alors, je valide la demande d’autorisation de dévier la trajectoire du vaisseau pour nous approcher du signal de détresse. Ça ne va prendre qu’une heure, mais ça va nous faire perdre deux semaines terrestres. J’entends déjà les autres râler. Surtout si c’est une balise fantôme.
Ça m’est arrivé une fois, déjà, de tomber sur ce genre de signal de détresse qui continuait d’émettre d’un navire longtemps après que l’équipage avait passé l’arme à gauche. Ils avaient pris un nuage de débris stellaires, presque impossible à détecter avant l’impact. Celui-là devait quand même être bien gros pour avoir défoncé la carlingue comme ça. C’était devenu une vraie passoire. L’équipage devait à peine avoir eu le temps de lancer le signal de détresse avant de mourir. Les pauvres.
Il faut espérer que ça ne va pas être la même cette fois. D’après l’ordi, il y a une trace de vie, ce qui explique la décision.
Munch débarque dans le cockpit alors que les moteurs ont à peine changé leur poussée.
« Qu’est-ce qu’il se passe, cap’ ? »
Je déteste quand il m’appelle « cap’ ».
« Un signal de détresse… »
Je ne fais pas de phrases. Quoi que je réponde, je sais qu’il va encore me les briser. Il a une femme, des enfants, il veut les revoir rapidement, c’est sa dernière mission, bla bla bla. Comme d’hab depuis vingt ans qu’on bosse ensemble.
« Sérieux, cap’ ? Personne d’autre peut y aller à not’ place ?
— Si on était dans la merde au point d’envoyer un signal de détresse, tu serais bien content que ceux qui le reçoivent se renvoient pas la responsabilité comme une patate chaude ! En tout cas, moi, je serai très content et reconnaissant qu’ils se bougent le cul pour sauver le nôtre. Donc, c’est ce que je fais. On ne perd pas beaucoup de temps par rapport à notre trajet.
— Tu parles… y en aura au moins pour dix jours, renâcle-t-il. Fait chier !
— Va plutôt prévenir la doc de se tenir prête à accueillir du monde et dis aux autres de se préparer à sortir. Si tu veux pas qu’on perdre trop de temps, t’as intérêt à ce qu’ils soient prêts dès qu’on accoste ! »
Munch repart en maugréant.
« Quel emmerdeur ! lâcha Emty, la navigatrice. Toujours à se plaindre. S’il est pas content, il a qu’à rester chez lui et trouver un boulot de fermier ! »
Je suis d’accord avec elle, mais en tant que capitaine, je ne peux pas le dire ouvertement, pour ménager les relations entre les membres de l’équipe. De toute façon, je crois qu’elle sait très bien ce que je pense. Cette gamine lit sur les visages aussi bien que sur les cartes galactiques.
« On s’attend à quoi exactement ? »
Misa, la docteure de l’équipe, toujours très économe en mots, à travers l’intercom.
« Aucune idée. Signal de détresse, pas de détails. Signes vitaux détectés. »
Je m’adapte à sa manière de parler sans même y penser, oubliant les verbes, les mots de liaison, les formules de politesse.
« ’K ! »
L’intercom s’éteint. Misa est aussi efficace dans son boulot que dans sa communication. C’est pour ça que tout le monde l’apprécie, même ceux qui préfèrent parler.
Le temps que tout le monde se prépare, nous sommes déjà en approche du navire naufragé. Il a l’air en parfait état hormis l’absence de lumière ou de signe de vie à l’intérieur. J’appelle, personne ne répond. L’ordinateur me confirme pourtant des traces de vie.
« À tout l’équipage, préparez-vous l’arrimage. Munch, vous êtes prêts à intervenir ?
— Yes, cap’ !
— Jouez pas les cow-boys, mais méfiez-vous de tout. L’ordi confirme des signes vitaux, mais personne répond.
— Putain, j’espère qu’on n’a pas fait ce détour pour tomber sur des pirates ! Je me ferai un plaisir de me les faire, sinon !
— Munch, fais pas le con, on a encore besoin de toi. Ça serait dommage de te faire trouer à ta dernière mission. J’ai pas envie d’aller voir ta femme pour lui annoncer ça, moi ! »
Je ne peux m’empêcher de lancer un regard vers Emty, qui dodeline de la tête et lève les yeux en signe de réprobation.
L’arrimage se fait sans soucis. La connexion de pont à pont idem. Je donne le go :
« Les flux vidéo sont nickel. Vous pouvez y aller quand vous voulez ! »
Leurs vidéos s’affichent en grand sur les écrans de contrôle. Ils ouvrent, entrent avec précaution et se séparent en deux équipes de deux. Munch part en tête vers le poste de pilotage avec Panlo ; Tom et Gurth à l’autre bout du vaisseau.
Ils fouillent le vaisseau qui n’est pas bien grand. Aucune trace de personne, comme s’il n’y avait même jamais eu ni pilote ni d’équipage.
« Panlo, tu peux te connecter à l’ordinateur de bord pour voir ce qu’il raconte ?
— C’est en cours, capitaine ! … C’est bizarre ça.
— Quoi ?
— Il n’y a rien dans le manifeste, aucun point de départ, aucun port d’arrivée, aucun historique, pas de nom de propriétaire, rien. Comme si la mémoire avait grillé, mais que le reste était fonctionnel.
— Tu arrives à voir ce qui a déclenché le signal de détresse ? »
Dans le micro de Panlo, j’entends Munch râler qu’on avait perdu tout ce temps pour que dalle… je ne peux pas vraiment le blâmer pour le coup.
« Capitaine ?
— Je t’écoute, Tom.
— Il y a des trucs bizarres de ce côté !
— Bizarres comment ? Plutôt bizarres rigolos ou bizarres dangereux ?
— Non pas dangereux, enfin, je crois pas. Mais il y a des caisses de transport dans les cabines d’équipage alors qu’il y a clairement personne.
— Tu arrives à en ouvrir une pour voir ? »
Je n’ai pas le temps d’imaginer quelque chose d’inquiétant qu’Emty m’apostrophe.
« Capitaine, on a un problème ! »
Je lève le nez vers les hublots. Un navire de guerre dix fois plus gros que nous s’approche. En fait, il est déjà sur nous, prêt à nous aborder. Je ne vois pas ses couleurs.
« Il est de quelle entité ?
— C’est ça le problème, capitaine. Je n’en sais rien. Il est invisible. Des pirates, vous croyez ? »
J’espère sincèrement que non, mais je ne vois pas d’autre explication plus logique.
« Putain, c’est des gens ! s’écrie Tom dans son micro.
— Quoi ?
— Il y a des personnes dans les caisses ! Enfin, ce sont des clones. Ils sont en train de maturer ! Ils sont presque prêts !! »
Voilà pourquoi l’ordinateur détectait des signes de vie. C’est de la contrebande de clones. Le signal était là pour indiquer aux pirates où les récupérer. Ils ne s’attendaient sûrement pas à ce qu’un vaisseau marchand soit si près pour intervenir.
« Laissez tout sur place et rentrez immédiatement ! Il faut qu’on dégage !! »
Je hurle presque dans mon micro.
Si on s’en sort entiers, Munch va me les casser longtemps sur mes principes à répondre aux signaux de détresse, je le sens. Pourtant d’après les éléments de l’ordinateur, son raisonnement et la décision semblaient solides.