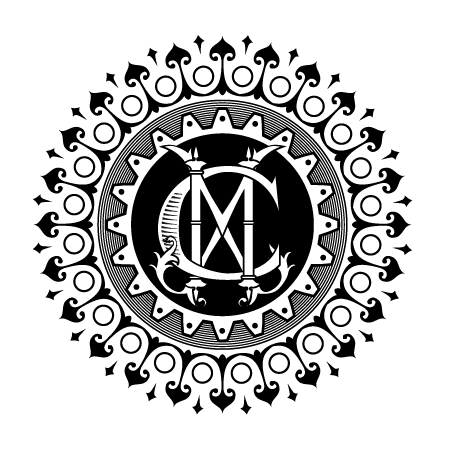Phrase donnée par Ambrose
« Mais qu’est-ce que vous avez fait du cercueil ?
L’employé des pompes funèbres regardait le sol comme un enfant qui a fait une grosse bêtise, jouant du bout du pied avec un caillou.
— Et la camionnette ? J’attends une explication claire et rapide ! J’ai un client qui demande des nouvelles de sa grand-mère ! J’aimerais pouvoir lui dire quelque chose ! «
Le patron n’était pas content du tout. C’était bien compréhensible. En trente ans de carrière, il n’avait jamais eu à déplorer de problème et depuis qu’il avait engagé cet hurluberlu, les erreurs s’enchaînaient jours après jours. Mais cette fois, il avait dépassé les limites. Perdre un véhicule et le cercueil qu’il contenait, comment était-ce possible ?
L’employé, que nous appellerons Larry pour lui garder des chances de retrouver du travail un jour, devait transférer le corps du lieu du décès vers le lieu de l’enterrement, soit un déplacement de près de huit cents kilomètres. Logiquement, il s’arrêta durant son périple pour manger un bout et prendre un peu l’air. Larry avait laissé la camionnette ouverte. Il ne voyait pas l’intérêt de verrouiller un corbillard. Mais alors qu’il urinait dans un fourré non loin de là, il en entendit un bruit de portière et n’eut que le temps de voir quatre personnes monter à l’intérieur et lui voler le cercueil. Ils le chargèrent dans une camionnette ressemblant en tout point à la sienne et partirent en trombe. Larry se dépêcha de remonter maladroitement sa braguette et jeter sa cigarette avant de sauter à son tour dans son corbillard, oubliant même de fermer les portes arrière. Il devait les rattraper et récupérer la boîte contenant Élisabeth Dubois, d’après les papiers officiels de transport.
Fonçant sur la route nationale — Le patron de Larry ne voulait pas qu’il prenne l’autoroute, question d’économie qu’il disait —, derrière l’autre véhicule, Larry arrivait à gagner un peu de terrain. Ils étaient quatre plus un corps, lui roulait à vide à présent.
Alors qu’il n’était plus qu’à une dizaine de mètres de la camionnette des voleurs, les portes arrière s’ouvrirent. Larry eut l’impression de vivre un épisode de l’agence tous risques. Deux des voleurs avaient des armes à feu. Larry n’y connaissait pas grand choses là-dedans, ça ressemblait juste à des mitraillettes. Ils n’attendirent pas pour faire feu. Dans un réflexe, Larry se baissa pour se protéger derrière le tableau de bord. Deux ou trois balles firent voler le pare-brise en éclat. De la fumée entra dans l’habitacle. Ces salauds avaient sûrement atteint le radiateur, voire le moteur même. Il allait se faire distancer. Rétrogradant tout en accélérant au maximum, Larry parvint à rejoindre la camionnette et à la percuter malgré le tir nourri des voleurs. L’impact fut immédiatement suivi d’un bruit étrange, comme une petite explosion. Le moteur venait de rendre l’âme, le véhicule de Larry se mit à ralentir. C’était fini. Il allait se faire virer. Relevant la tête, il vit les malfrats s’éloigner mais fut stupéfait de voir glisser au milieu de la route le cercueil qui lui avait été volé. L’impact l’avait sûrement fait tomber. Pourquoi les voleurs avaient préféré s’enfuir plutôt que de le récupérer, Larry n’en savait rien. Il le comprit rapidement en se faisant dépasser par trois véhicules de police. Un quatrième s’arrêta devant lui. Le conducteur sortit rapidement et braqua son arme sur le convoyeur des pompes funèbres qui leva les mains, tremblant de peur.
Menotté, la joue contre le métal froid de la carrosserie de sa camionnette, Larry se demandait ce qu’il allait lui arriver. Le collègue du policier qui venait de l’arrêter était allé voir le cercueil et revenait tranquillement.
« Vous savez ce que contient ce cercueil ? demanda-t-il.
— Madame Dubois… bafouilla Larry, Élisabeth Dubois, née le 24 septembre 1927, morte il y a trois jours. Je l’emmène pour qu’elle soit enterrée dans le caveau familial.
Le policier montra à Larry une poche transparente entourée de cellophane remplie de poudre blanche.
— À moins qu’elle n’ait déjà subit sa crémation, je ne suis pas sûr que ce soit elle… »
À cet instant du récit, le patron de Larry le coupa.
« Quoi ? Il y avait de la drogue dans le cercueil ? Vous vous foutez de moi ! Ça n’est pas possible, j’ai scellé le cercueil moi-même !! »
Larry regarda son patron d’un air défaitiste en haussant les épaules. Il avait perdu une dépouille et était inculpé de trafic de drogue par la police. Ces états d’âme ne l’atteignaient pas trop.
« Mais qu’est devenue la mamie ? Et comment vous êtes vous retrouvé en possession de cette marchandise ?
Larry haussa une nouvelle fois les épaules.
— Je ne veux plus vous voir ! Vous êtes viré ! Allez-vous-en ! »
Pendant que Larry s’éloignait tranquillement de son nouvel ex-travail, son nouvel ex-patron entra furieux dans son bureau. Il décrocha le téléphone.
« C’est moi ! Quelqu’un savait pour le transport. Mon idiot s’est fait attaquer avant de se faire arrêter par les filcs ! … Évidemment qu’ils ont saisi la marchandise ! Putain !! Cent-cinquante kilos de dope. C’était facile, ça devait se passer sans problème ! Trouvez la taupe et faite lui comprendre qu’on joue pas aux cons avec l’argent des autres ! »
Le patron raccrocha. Au même instant, un jeune homme d’une trentaine d’années entra dans le bureau.
« La gestion administrative, c’est au secrétariat ! » aboya le patron, visiblement sur les nerfs.
Le jeune homme sortit de sa poche un porte feuille qu’il ouvrit d’un mouvement mécanique, montrant son habitude, et laissant apparaître une carte d’officier de police. Le patron laissa tomber sa tête et ses épaules sous le poids de la fatigue. Ça n’était vraiment pas son jour.