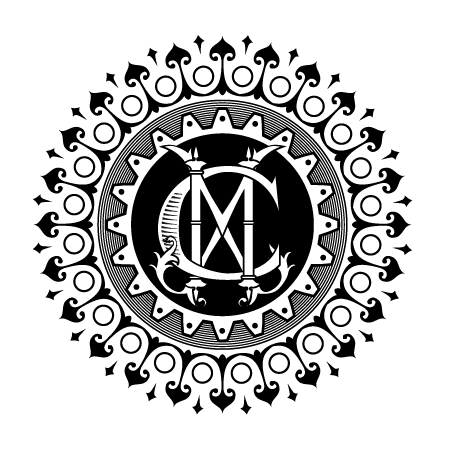Phrase donnée par Luigi B.-B.
Cet exercice me permit de réaliser que mon ancien métier m’avait appris à imaginer des introductions venues de nul part. Évidemment, dans la situation actuelle, introduire n’était pas chose suffisante. Il fallait aussi que je conclue. Et une arme pointée sur moi, ça n’était forcément si simple.
Au moins, mes deux agresseurs semblaient captivés par ce que j’avais commencé à leur raconter.
Sur le quai aérien de la gare, j’attendais tranquillement mon train pour rejoindre ma banlieue non moins tranquille. Je n’espérais rien de plus que de pouvoir embrasser ma femme et mes gosses et me poser dans mon fauteuil avec un bon verre de bourbon. La semaine avait été assez difficile. Je travaillais à présent dans un cabinet d’experts comptables et là, nous préparions les déclarations de nos clients. Rien de bien folichon mais ça demandait une bonne dose de concentration et c’était la période où les horaires étaient le plus élastiques. J’en avais plein les bottes.
Et là, alors que j’étais tout seul sur ce quai, ces deux idiots s’approchèrent de moi. Le premier me demanda une cigarette, avec un ton des plus détestables et un manque total de marque de politesse. Manque de bol pour lui, je ne fume plus. J’ai réussi à lâcher cette saloperie depuis quatre ans, après la mort d’un pote, une longue histoire… Bref, je répondis au gars que non, je n’avais pas de clope, me retenant bien de rajouter que même en cas contraire, il aurait toujours pu courir pour que je lui en lâche.
Le second me demanda si je pouvais lui prêter mon téléphone portable pour qu’il puisse appeler sa mère parce que le sien n’avait plus de batterie. Je sentais les problèmes arriver. C’était le coup classique des deux bonhommes qui veulent voler un portable ou autre chose et tentent d’abord d’endormir l’attention de leurs proies. Je mentis que mon portable non plus n’avait plus de batterie en me levant pour vérifier l’heure. Je ne voulais pas me battre et je sentais que le temps jusqu’à l’arrivée de mon train allait être long, très long. Il allait falloir palabrer pour leur tenir la jambe. Je détestais ça.
Les deux me firent barrage, de peur que je m’enfuie ou peut-être parce qu’ils y virent un moyen facile de me faire les poches. D’ailleurs je sentis immédiatement la main du second comparse essayer de fouiller la poche de ma veste. Je lui attrapai le poignet avant même de m’en rendre compte. J’avais encore quelques réflexes.
Repoussant mon pickpocket avec quand même une certaine délicatesse, je commençai par dire au deux qu’il n’était pas judicieux de commencer sur ce chemin, qu’il était encore temps pour eux de partir sans problème pour personne.
Finalement, le premier sortit un couteau papillon standard, lame d’une vingtaine de centimètres, manche de merde, le tout fabriqué en Chine ou à Taïwan.
C’est là que je partis commençai mon introduction venue de nul part, expliquant de façon plus ou moins nébuleuses l’art d’attaquer au couteau, détaillant pourquoi ce type-ci n’était pas adapté et surtout pourquoi il n’était pas adapté contre quelqu’un comme moi. Les deux idiots me regardèrent quelque peu interdis.
C’était là, qu’il fallait que je passe au développement de mon argumentaire. Je le voyais bien dans leurs regards qui se remplissaient de colère. J’aurais pu essayer de continuer à discourir avec ces deux imbéciles mais j’étais fatigué et je voulais être tranquille le plus rapidement possible. J’optai pour la parti pratique de mes explications.
D’un mouvement rapide, j’attrapai à deux mains ma sacoche de dossier et appuyai violemment avec contre la pointe de la lame. Celle-ci glissa dans la main de mon agresseur, le coupant profondément au passage. Profitant de la surprise, je décochai un grand coup de mon sac dans la tête du second avant de lui mettre un violent coup de pied au cul. Il s’écroula par terre lourdement.
Le premier se tenait la main comme si elle allait tomber. Elle saignait à peine. Je lui balançai ma sacoche dans le menton, il tomba à la renverse. Pendant que son soi-disant ami prenait son courage à deux mains pour fuir, j’attrapai le blessé à moitié sonné et le traînai au bord du quai. Mon train arrivait au loin.
Sa tête à moitié dans le vide au-dessus des voies, il essayait de se débattre pour se défaire de mon étreinte mais il n’arrivait à rien. Un de mes genoux sur sa poitrine, l’autre pied sur sa main encore en état, il était incapable de faire quoi que ce soit d’efficace, à part étaler son sang sur ma veste de costume. Je l’avais attrapé par le col et le secouait .
« Tu vois le train qui arrive ? Tu le vois ? commençai-je à crier.
Oh ! Oui ! Il le voyait bien, je le lisais dans ses yeux.
— Je pourrais attendre ici qu’il arrive et t’arrache la tête ! C’est ça que tu veux ?
Il secoua la tête frénétiquement tout en criant que non, plus quelques excuses mal placées et tellement pathétiques.
— Je ne veux plus jamais voir ta sale petite gueule ni celle de ton pote dans le coin si tu ne veux pas que ça arrive, c’est clair ?
Nouveau secouage de tête mais dans l’autre sens, cette fois.
Le train arrivait. Il nous avait vu et klaxonnait tant qu’il pouvait pour nous faire comprendre le danger. J’attendis encore un court instant pour relever mon agresseur qui regardait la locomotive comme un lapin les phares d’une bagnole, et l’envoyer valser. Je lui assenai un grand coup de pied dans le cul au passage, comme à son ami.
— Dégage maintenant ! Et loin !! » criai-je pour couvrir le hurlement des freins.
Les portes des voitures s’ouvrirent, laissant sortir deux, peut-être trois passagers. Je montai à mon tour, réalisant que mon ancien métier, en plus de m’avoir appris toutes les techniques de corps-à-corps utiles pour ce genre de situation m’avait permis aussi d’apprendre à faire de belles introductions pour embrouiller ces petites frappes.