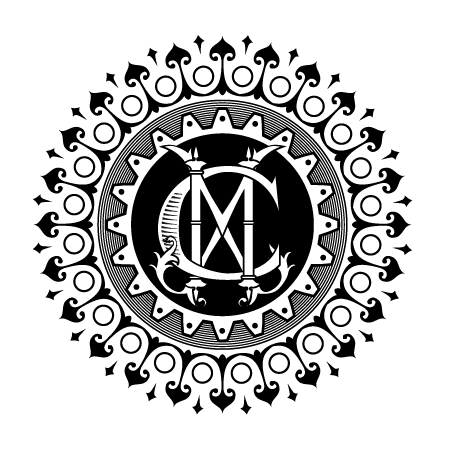Elle tourna la clé dans la serrure et pénétra dans l’appartement. Elle sentit immédiatement que quelque chose ne tournait pas rond.
Freddy, son pangolin de compagnie, gisait à plat ventre sur le sol de l’entrée, la langue pendante, ses quatre pattes dépassant de sa carapace comme s’il s’était subitement effondré sous son propre poids. Il était parfaitement immobile, statufié sur le sol en béton ciré. Ses griffes étaient sorties et ses écailles métalliques hérissées, et sur son petit museau pointu, ses yeux demeuraient d’un noir mat, absolument inexpressifs. Que s’était-il passé ?
D’ordinaire, dès qu’elle poussait la porte de son appartement, Freddy s’élançait vers elle pour l’accueillir en trottinant sur ses deux pattes arrière, avant de lui tourner autour en poussant de petits jappements électroniques. C’était apparemment ce qu’il avait essayé de faire avant de se retrouver figé en pleine course à deux mètres de la porte d’entrée. Elle soupira. Évidement, Freddy n’était plus sous garantie. Et, évidement, la réparation serait hors de prix. Elle s’agenouilla à côté de la carcasse métallique, laissant glisser ses doigts sur les écailles froides, réfléchissantes comme des miroirs. Combien de temps devrait-elle attendre avant qu’il soit remis en état ? Elle s’imaginait mal rester une semaine entière sans robot de compagnie. L’idée d’en commander immédiatement un nouveau – pourquoi pas un tatou, pour changer – l’effleura, mais elle la chassa de son esprit, se sentant immédiatement coupable d’elle ne savait trop quoi. Elle n’avait pas du tout les moyens d’une telle folie, sans compter que, même si cela paraissait absurde, elle s’était attachée à Freddy. Elle savait bien que l’intelligence artificielle n’existait pas vraiment et que chacun des traits de comportement de Freddy étaient programmés à l’avance, ne faisant que se succéder et se combiner aléatoirement afin de mimer le côté hasardeux de la vie. L’illusion était bonne, cependant, et elle prenait plaisir à jouer à y croire.
Ce ne fut qu’au moment où elle se releva qu’elle réalisa réellement ce qui clochait dans son appartement. Jusque là, accaparée par Freddy, elle était passée à côté de l’essentiel. Elle avait eu vaguement conscience d’un éclairage modifié et de l’absence de la musique qui se déclenchait habituellement à son arrivée – un concerto pour flûte électrique – sans toutefois s’en alarmer autant qu’elle aurait dû. Désormais, elle vacillait dans son vestibule, ne sachant quelle attitude adopter. L’anomalie dépassait de loin le cas particulier de Freddy. Elle contemplait son appartement baignant dans l’éclairage blanchâtre de secours. Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait affaire à une panne électrique de grande ampleur, qui concernait peut-être toute la tour d’habitation. Elle jeta un coup d’œil à l’extérieur afin d’en avoir le cœur net. Effectivement, la même lumière blanche, blafarde, baignait le couloir. L’incident semblait s’être produit au moment exact où elle avait ouvert sa porte. Elle n’avait jamais connu cela auparavant et tentait désespérément de se remémorer la charte de sécurité en petits caractères qu’elle avait négligemment signée lors de son emménagement. Combien de temps tiendraient les batteries des lampes de secours ? Elle n’en avait aucune idée. Tout ce qu’elle savait, c’était que dans un cas pareil, toute la domotique de la tour était hors service, ascenseurs compris. Finalement, ce n’était peut-être pas une si bonne idée que d’habiter au cent dixième étage ! Sans compter qu’il faisait déjà nuit dehors, et que lorsque les lumières s’éteindraient, elle se retrouverait dans le noir complet.
Tout cela lui avait donné une décharge d’adrénaline. Son cœur pompait son sang avec force et elle recevait par salves des bouffées de chaleur qui s’émoussaient en frissons de sueur glacée, plaquant ses vêtements contre son corps. Elle avait les mains moites. Ça n’allait pas. Non : ça n’allait pas bien du tout, et il fallait faire quelque chose. Mais quoi ?
Elle laissa tomber son sac à main par terre, enjamba Freddy, et s’avança dans son salon en clignant des yeux. Cette lumière était effroyable. N’aurait-il pas mieux valu en diminuer l’intensité afin d’économiser les batteries ? Elle avait la sensation de manquer d’air et devait se raisonner en se rappelant que c’était pourtant la seule chose dont elle n’avait pas à se soucier ce soir. Quoi qu’il arrive, elle respirerait.
Elle avait l’impression de découvrir son appartement pour la première fois. Tous les écrans tapissant les murs et les plafonds étaient éteints, dévoilant pour la première fois les surfaces nues.
D’habitude, chaque pièce était affublée de son papier peint personnalisé et animé. Elle pouvait varier les fonds d’écran à l’infini, et grâce à la technologie 3D à pixels invisibles vantée dans les publicités, ceux-ci étaient toujours plus immersifs. Depuis quelques mois, elle avait pris l’habitude de dîner dans la nef colossale de la basilique Saint-Pierre de Rome, sous la coupole ornée de mosaïques. Elle prenait son bain en mer, immergée à plusieurs mètres sous la surface, admirant des bancs de poissons argentés entre les algues, et remontant du regard les chaînes d’interminables ancres, jusqu’aux minces coques des bateaux dodelinant au plafond.
L’appartement, d’ordinaire immense, lui apparaissait désormais dans sa triste réalité : quatre pièces minuscules et vides. Désorientée et fascinée à la fois, elle passa ses mains sur les murs, caressant le revêtement homogène de plastique blanc et lisse. Personne n’était censé voir l’envers des choses. Les quelques meubles qu’elle possédait – pour l’essentiel une table, deux chaises, une baignoire et un lit – semblaient jurer, isolés dans ce décor blanc. D’ordinaire, personne ne pouvait éteindre les écrans. Qui, d’ailleurs, aurait songé à demander une chose pareille ? Sauf dans la chambre, évidement. Lorsqu’on se mettait au lit, les écrans s’éteignaient en même temps que la lumière afin de plonger la pièce dans un noir complet. Mais cela n’aidait pas à se rendre compte de l’apparence réelle des choses. Il avait fallu cette panne pour lui ouvrir les yeux.
Mais s’il n’y avait que ça…
« Tiroir. Ouvrir. »
Elle parcourait le cube blanc qui lui servait d’appartement en réalisant à chaque seconde à quel point la domotique s’était immiscée dans sa vie. Le design de fin de vingt et unième siècle se voulait minimaliste et épuré. Les tiroirs et placards n’étaient plus que des surfaces lisses et laquées. Leur ouverture se commandant à la voix, les poignées avaient disparu et les portes n’étaient plus que des plaques sans aucune aspérité. Rien, absolument rien, ne devait dépasser. Sauf que ce soir-là, le frigo et le micro-ondes refusaient obstinément de s’ouvrir, les placards gardaient jalousement leurs provisions et les tiroirs retenaient en otage jusqu’à la moindre petite cuillère. Sa cuisine intégrée était devenue un adversaire, un bloc glacé d’entêtement hostile. En outre, l’ensemble était solide, inattaquable, et de toute manière, elle n’avait pas d’outils.
Dans la chambre, ce n’était pas mieux. Son armoire se montrant aussi récalcitrante que le reste, il lui faudrait renoncer à changer de chaussures et de vêtements. Mais le pire, c’était la robinetterie. Saisie d’un doute, elle se rendit dans la salle de bain, s’agenouilla à côté de la baignoire, et d’une voix forte et claire, elle déclama :
« Eau chaude »
« Eau froide »
Rien, évidement. Elle testa l’évier de la cuisine ainsi que la chasse d’eau des toilettes. Pas une seule goutte d’eau. En outre, il commençait à faire froid. Et, bien sûr, tous les thermostats étaient éteints.
L’état des lieux fut vite fait, et il était catastrophique. Comme prévu, toute la domotique de l’appartement était hors service. Elle n’avait accès à rien, pas même au mécanisme d’ouverture des volets roulants, qui s’étaient abaissés automatiquement une demie-heure après le coucher du soleil. Elle regrettait de ne pouvoir jeter un regard sur la ville. Une inquiétude la rongeait : et si coupure électrique s’étendait à toute la cité ? Lorsque les lampes de secours lâcheraient, les gratte-ciel ne seraient plus que des squelettes noirs et inanimés et la nuit dévorerait la ville. Elle en avait des sueurs froides. Comme tout le monde dans cette société saturée de néons, elle était terrifiée par l’obscurité.
Désemparée, elle eut le réflexe de consulter son brassard connecté, mais comme par un fait exprès, celui-ci n’avait plus de batterie. Elle avait passé trop d’appels holographiques ce jour-là et, désormais, elle s’en mordait les doigts. Si elle avait su… Elle aurait payé cher, désormais, pour pouvoir sonder pendant quelques secondes les réseaux sociaux ou les sites d’information. Il devait bien y avoir, quelque part, des gens qui savaient quelque chose. Elle ne pouvait pas rester là, toute seule, à attendre que l’éclairage de secours s’éteigne. Elle qui aimait afficher des horloges sur tous ses murs, ne savait même plus quelle heure il était. Cela ne pouvait plus durer ; elle ne pouvait pas rester comme ça. Le pire, dans ce genre de situations, c’était l’incertitude. Alors, après un dernier tour d’horizon déprimant sur ses quatre pièces blanches, elle se dirigea théâtralement vers le vestibule. Il n’y avait personne pour la voir, mais elle aimait être l’héroïne de ses propres pièces, la dramatisation l’aidant à convoquer son courage. Elle ramassa son sac à main et jeta un dernier regard au petit museau triangulaire de Freddy, presque comme si elle n’allait jamais revenir. Puis elle poussa la porte et se retrouva dans le couloir. En tournant sa clé dans la serrure, elle se souvint d’avoir souvent pesté contre ce système antédiluvien, qui la mettait en difficulté à chaque fois qu’elle rentrait les bras chargés de courses. Aujourd’hui, pourtant, elle en comprenait l’utilité.
De part et d’autre du couloir, des portes s’ouvraient, se refermaient, et des visages inquiets passaient par les entrebâillements. Des gens s’agglutinaient devant l’ascenseur. Certains portaient des sacs à dos, dans lesquels ils avaient dû fourrer ce qu’ils avaient pu arracher à leurs placards. D’autres tenaient par la main des enfants réveillés à la hâte, encore engourdis de sommeil. Visiblement, livrés à eux-mêmes, les habitants avaient spontanément opté pour une évacuation de l’immeuble. Elle suivit le mouvement en direction de l’ascenseur sans y croire vraiment. Comme elle s’en doutait depuis le début, celui-ci était hors service, jusqu’au bouton d’appel qui demeurait désespérément sombre. Toutefois, certains refusaient de rebrousser chemin et se contentaient de stationner stupidement devant les portes retorses, le regard vide et les bras ballants, attendant sans doute un hypothétique retour du courant. D’autres commençaient à s’agiter et à vociférer, déclarant que tout ceci était parfaitement inadmissible, que ça ne se passerait pas comme ça, et réclamant les têtes des coupables sur des piques. Le vacarme faisait s’ouvrir les dernières portes, faisant surgir les derniers retardataires de leurs lits. Un certains nombre étaient en pyjamas, preuve que bien des armoires avaient refusé de s’ouvrir. Sous l’éclairage blême, les teints étaient cireux et les rides marquées. L’air était poisseux d’angoisse.
Constatant que les agitateurs constituaient autour d’eux des groupes de plus en plus denses, elle jugea plus sage de s’éloigner. C’est alors qu’elle aperçut un éclair lumineux dans le coin de son champ de vision. Cela ne dura qu’une fraction de seconde, et pourtant, elle état sûre de ce qu’elle avait vu. Quelqu’un avait un brassard connecté en état de fonctionnement et s’était empressé de le cacher sous sa manche. Elle l’identifia rapidement une vieille femme terrorisée, appuyée contre un mur comme si elle voulait disparaître à l’intérieur de la cloison. La femme se tenait le bras gauche comme si elle cherchait à dissimuler quelque chose. Les vieux étaient bien les seuls à pouvoir faire durer leurs batteries des jours entiers.
Soudain, la vieille femme se décolla de son mur et, tournant le dos à l’ascenseur, entreprit de remonter la marée humaine à contre-courant. Elle la suivit comme elle put en heurtant des épaules, marchant sur des pied et bredouillant des excuses. Cette femme était son seul lien avec le monde ; il ne fallait pas qu’elle la perde de vue.
Tout au bout du couloir en forme d’équerre, passé le tournant, il n’y avait plus personne. La vieille femme paraissait soulagée d’avoir semé le reste de la troupe et ne semblait pas la considérer comme une menace. Alors, la vieille lui désigna d’un geste une porte grise, ornée d’un écriteau à la typographie datée. Elle lut :
« Escaliers de secours »
Elle éclata d’un long rire nerveux. Pourquoi n’y avait-elle pas pensé elle-même ? Pourquoi personne n’y avait-il pensé ? Seuls les vieux pouvaient se rappeler de ce genre de choses. Il fallait bien avoir soixante-dix ans pour avoir connu les escaliers. Toutefois, la vieille s’alarma de sa manifestation de joie. Elle plaça son index sur ses lèvres et la poussa vers la porte grise.
— Vous ne voulez pas avertir les autres ?
La vieille secoua la tête avec gravité.
— N’y pensez pas. Nous vivons dans une tour de cent cinquante étages et c’est l’unique escalier. Croyez-moi ; vous n’avez pas envie d’être prise dans les embouteillages !
— Mais… les autres ?
— Ne vous inquiétez pas pour eux. Lorsqu’ils auront fini de tourner en rond et de s’échauffer, ils trouveront la cage d’escaliers. Ce n’est qu’une question de temps. Et nous, nous allons juste prendre un peu d’avance.
Elle avait à peine fini de parler que dans un claquement sinistre, l’éclairage de sécurité lâcha. Des cris terribles jaillirent du fond du couloir. Des objets tombèrent. La vieille remonta sa manche pour s’éclairer avec son brassard. Puis, sans plus de cérémonie, elle ouvrit la porte et disparut de l’autre côté. Elle la suivit, le cœur battant. Sa comparse n’était plus de première jeunesse ; elle était frêle et tremblante, et elle se demandait par quel miracle celle-ci réussirait à atteindre le rez-de-chaussée.
La descente par les escaliers de secours était comme une plongée dans le temps. À chaque étage, un petit palier leur permettait de reprendre leur souffle quelques seconde. Et, à chaque fois, il y avait une porte grise surmontée d’une veilleuse de secours surannée, qui devait être hors service depuis des décennies. Elle reconnut ces symboles qu’elle avait déjà rencontrés dans de nombreux musées. Sur un fond vert, un personnage stylisé courait vers un rectangle blanc, assorti d’une flèche épaisse. Pour chaque étage, un gros numéro était peint en blanc, au pochoir, sur le mur. Les nombres défilaient avec lenteur mais régularité.
Cent cinq. Cent. Quatre-vingt-quinze. Quatre-vingt-dix.
La vieille avait mis son brassard en mode économie d’énergie et s’agrippait soigneusement à la la rampe. Elle ne se plaignait pas, mais elle était de plus en plus courbée et respirait d’une voix rauque. Leur univers était limité aux cinq ou six marches éclairées par le petit halo mouvant. Combien de temps mettraient-elle à descendre les cent dix étages. La vieille femme la surprenait par sa détermination. Tout en avançant, un pied après l’autre, un bras passé sous celui de la vieille pour la soutenir, elle faisait ses petits calculs. À raison de quarante-cinq secondes par étage, elles mettraient une heure et vingt-deux minutes. C’était impressionnant.
Soixante. Cinquante-cinq. Cinquante. Quarante-cinq.
Au début, elles n’avaient croisé personne. Mais plus elles progressaient, plus elles rencontraient de monde. La cage d’escalier était envahie de grands-pères et de grands-mères déterminés, s’enfonçant brassards allumés dans le ventre de béton de l’immeuble. Certains étaient même munis de briquets ou de lampes à gaz. Avec ce qu’ils portaient sur eux, on aurait pu ouvrir un musée. Sa petite grand-mère ne déméritait pas et mettait un point d’honneur à ne prendre aucune véritable pause. Lorsqu’elles doublaient les plus faibles, elle les encourageait même d’un sourire.
Quinze. Dix. Cinq.
Il y avait de plus en plus de jeunes dans l’escalier. Les portes grises claquaient. Des jeunes couraient et slalomaient entre les vieux, qui s’accrochaient à la rampe comme à une ligne de vie. Certains laissaient passer les bolides en serrant contre leur poitrine le cadavre métallique d’une taupe ou d’un hérisson de compagnie qu’ils n’avaient pu se résoudre à abandonner. C’était de plus en plus encombré. Elles avaient bien fait de partir tôt.
Zéro.
Jamais elle ne se serait attendue à ça.
Toute la ville était plongée dans le noir. Les gratte-ciel éteints étaient des monolithes d’un noir mat, comme les blocs titanesques d’un jeu de construction effrayant, dont on aurait égaré le mode d’emploi. Les voitures étaient à l’arrêt sur les pistes magnétiques transformées en voies piétonnes. Les gens se déversaient dans la rue et grouillaient partout. Peu avaient des brassards allumés, mais pourtant elle les voyait. La foule était une mer ondulante et compacte qui menaçait de l’absorber. Comment parvenait-elle à distinguer autant de détails ? Comment était-ce possible ?
Elle avait toujours connu la ville scintillante, pulsante, stroboscopique. La ville lui avait toujours fait mal aux yeux. Elle avait grandi avec ces toiles de brume vaporisées entre les immeubles, à l’horizontale, et servant de faux-plafonds publicitaires. Il y en avait plusieurs couches à des altitudes variées afin que chacun puisse en profiter dans les étages. Elle n’avait jamais connu le ciel. De nuit comme de jour, l’air était juste une glu de lumière, de couleurs et de messages défilant en surimpression. Alors, elle s’était imaginée que la nuit allait être noire. Elle s’était trompée.
La foule entière levait les yeux au ciel. À côté d’elle, la vieille femme pleurait en silence, émue. Les immeubles se détachaient sur un poudroiement d’or. En l’absence de pollution lumineuse, la Voie Lactée emplissait tout l’espace, exposant sa tranche sertie de nébuleuses et de poussières. Sur l’horizon sud, le bulbe galactique paraissait énorme. Le ciel était si lumineux que les bâtiments et les gens projetaient des ombres sur le sol.
Peu importait que cette panne dure quelques heures ou quelques jours. Peut importait qu’elle touche la ville ou l’ensemble de la planète.
Pour la première fois de sa vie, elle voyait les étoiles.
Amandine