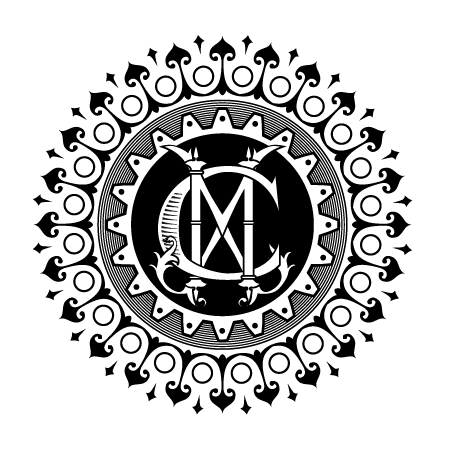Si vous n’avez pas lu les parties 1, 2 et 3 sont par ici :
897 mots
Éric revint et interrompit le gardien avant qu’il n’eût pu raconter quoi que ce fût.
« Qu’est-ce que vous chuchotez tous les deux ?
— Rien, rien, répondit Pierre, sans la moindre trace de culpabilité. La jeune femme me racontait comme tu l’avais sauvée, tout à l’heure. Heureusement que tu étais là. »
Éric grogna en forme d’approbation puis se tourna vers Hélèna.
« Vous devriez entrer pour vous trouver une place. Je me suis mis dans le premier dortoir à gauche. C’est le plus près de la douche. Mais vous faites comme vous le sentez. D’ailleurs, profitez peut-être qu’il n’y a personne et encore de l’eau chaude pour vous rafraîchir. »
La photographe le remercia et partit suivre son conseil. Elle n’avait jamais été adepte de la vie en collectivité. Elle n’avait fait qu’une seule colonie de vacances, vers 10 ans, et en était rentrée traumatisée. Elle s’était juré de ne plus jamais subir ce genre de traitement. Même pendant ses études, elle avait réussi à ne pas vivre dans des colocations de plus de trois personnes, et ç’avait déjà été suffisamment difficile. Elle appréhendait la soirée et surtout la nuit, avec son lot de ronfleurs et les odeurs de pieds.
Quand elle sortit de la douche, un groupe de six personnes avait rejoint le refuge et était en train de s’installer, à grands coups d’éclats de rire et de voix. Même s’il s’agissait d’un groupe de préretraités, qui semblaient autrement très polis et bien élevés, Hélèna s’inquiéta encore plus de sa nuit.
Les groupes continuèrent d’affluer au cours de l’après-midi, de deux à dix personnes, de tous âges, être près de trente en fin de journée. À l’heure à laquelle Hélèna prenait plutôt l’apéro d’afterwork avec ses collègues, tout le monde se retrouva dans la pièce commune pour le dîner. Il y avait là une effervescence étrange qu’Hélèna ne s’attendait pas à découvrir. Les gens discutaient les uns avec les autres, sans rester dans leurs groupes d’origines, sur des sujets aussi divers que la randonnée, évidemment, la cuisine des pommes de terre en altitudes, l’économie du secteur sucrier en Bolivie ou l’Histoire indo-européenne du XIIe siècle.
Ce ne fut qu’au bout d’un bon moment que la jeune femme se rendit compte de l’absence d’Éric. Elle ne l’avait pas revu depuis le début de la préparation du repas pour laquelle elle s’était portée volontaire et avait aidé tant bien que mal.
Hélèna se faufila entre les bancs de randonneurs prêts à chanter des chants montagnards, pour rejoindre Pierre, qui finissait de ranger les gamelles à la cuisine pour la corvée de plonge.
« Vous n’avez pas vu Éric ?
— Ah ah, il vous manque déjà ? la taquina le gardien. Il ne devrait pas tarder à revenir. Vous avez expressément besoin de lui ?
— Expressément, non, mais je m’étonne qu’il n’assiste pas au repas. Il va falloir des forces pour demain… enfin cette nuit. Il m’a dit qu’il y avait au moins quatre heures de marche. Il ne va pas les faire l’estomac vide !
— Ne vous inquiétez pas ma petite dame. Il connaît très bien son métier et il se connaît aussi très bien. Il sera en forme à l’heure et pour tout le temps qu’il faudra.
— D’accord… »
Hélèna allait quitter la cuisine pour revenir dans la salle commune emplie de chants quand elle repensa à ce que Pierre avait essayé de lui dire plutôt.
« Que vouliez-vous me dire tout à l’heure quand Éric vous a interrompu ?
— Rien de spécial. Je n’aurais dû rien dire.
— Vous m’avez dit qu’il avait failli y passer un peu comme moi, ce matin. Vous avez piqué ma curiosité.
— Je suis désolé, ma petite dame, mais j’en ai trop dit. Éric ne serait pas content que je vous en parle. Demandez-le-lui si vous voulez vraiment savoir. Mais comme vous devez vous lever aux aurores, vous devriez plutôt aller dormir. »
Hélèna comprit qu’elle ne tirerait rien de plus du gardien.
L’estomac plein, elle se sentit tout à coup la fatigue l’envelopper. Les activités physiques, le grand air et les émotions trop vives, elle n’était pas habituée à tout cela. Le gardien avait peut-être raison. Mieux valait-il aller se coucher. Elle espérait qu’elle parviendrait à fermer l’œil avec les chants qui continuaient dans la salle commune.
Dans le dortoir, elle découvrit la cachette de son guide : il dormait allègrement. La lumière ne sembla pas le gêner. Hélèna se glissa dans son sac de couchage, se rendant bien compte qu’il était bien moins confortable que celui que lui avait prêté Éric la veille.
La photographe dormit d’un sommeil de plomb, mais rempli de rêves. Elle était au beau milieu de l’un d’eux quand Éric y apparut. Il était grand, ténébreux, torse nu. Hélèna ne pouvait détacher son regard de son corps si bien taillé. Il s’approchait d’elle lentement, la fixant dans les yeux, il s’approchait de plus en plus, au point d’être presque collé contre elle. Finalement, il posa les mains sur ses épaules et lui susurra :
« Debout ! C’est l’heure ! »
Il fallut un instant à Hélèna pour revenir dans le monde réel. Heureusement que la pièce était sombre, il ne put voir qu’elle était rouge comme une pivoine.
« Faites pas trop de bruits, pour pas réveiller les autres ! Et n’oubliez rien derrière vous ! Je vous attends dehors. »
Hélène ne sut si elle était déçue ou soulagée d’avoir été réveillée à ce moment.