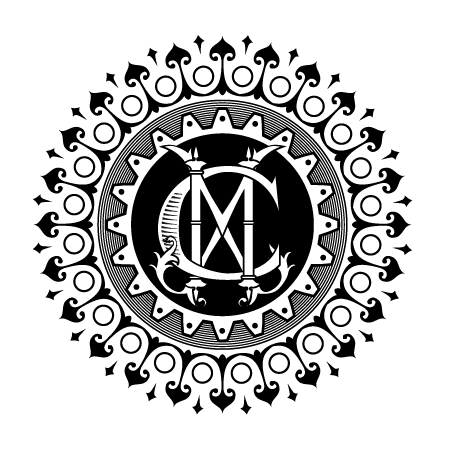Cette semaine, notre guest star est Chris Mallory, auteur de science-fiction.
Sa bio :
Passionné de SF, Chris Mallory a dévoré à l’adolescence des auteurs comme Asimov, Clarke et Herbert et a écrit sa première nouvelle de SF à 13 ans. Après des études universitaires, tout en continuant à écrire, il est devenu informaticien puis webmaster. Il vit aujourd’hui à Strasbourg et se consacre à l’écriture à plein-temps.
Doppelgänger
Hong Kong, 2099
Il regarda le sang s’écouler dans le caniveau, puis remonta son flot paresseux jusqu’à un pied nu dépassant des sacs-poubelle entassés par des voisins peu respectueux. Un pied de femme, soigné et habillé d’une fine et élégante sandale à talon haut.
Avec des gestes las, il dégagea les sacs en plastique remplis de détritus dont l’odeur lui donna une vague nausée. Son binôme l’aida. C’était bien un corps de femme, à moitié dénudé, vêtue d’une élégante robe en soie. Le visage était caché par les cheveux bruns soyeux de la morte, qui n’en était pas une. C’était un robot de compagnie, un des derniers modèles à voir la perfection de la machine, qui était si proche de l’humanité que sans la plaie béante au ventre, qui dévoilait les circuits électriques, on s’y serait trompé.
— Et le recyclage, c’est fait pour les chiens ? grogna le lieutenant Julie Chow. Regarde-moi ça, il y en a partout !
— Cherche son code-barre, dit le lieutenant Johnny Wu en regardant la créature avec pitié. On va envoyer une bonne amende à son proprio. En attendant, ne la laissons pas là. Si des gosses la voient…
— Tu parles ! Ils piqueront les pièces détachées autant qu’ils pourront, ironisa Julie. Les gosses, de nos jours, ce n’est pas une andro morte qui va les émouvoir.
— Pourtant, celle-là a morflé, remarqua Johnny Wu.
L’andro était couverte de bleus et de coupures. Il était probable qu’elle avait été méthodiquement tabassée par son propriétaire, avant qu’une panne, probablement provoquée par la plaie au ventre, ne mette fin à ce jeu sadique. Wu se demandait comment des hommes – c’était le plus souvent des hommes, il devait le reconnaître, à sa grande honte – pouvaient dépenser de l’argent dans des andros dernier modèle juste pour se défouler dessus. Ces andros avaient une apparence totalement humaine, et leur peau était conçue pour réagir aux stimuli extérieurs, comme des coups, des coupures, des brûlures. Ils ou elles, mais c’était à 95% des modèles féminins, étaient programmés pour crier, pleurer, supplier, hurler quand elles étaient torturées. Le modèle avait déclenché les foudres des féministes et le gouvernement chinois s’était saisi de l’affaire. On parlait de l’interdire. Les modèles enfantins avaient déjà été interdits. Mais AndrosCorp, la firme hongkongaise qui les produisait, avait fait appel à tous ses soutiens politiques pour freiner la procédure concernant les modèles adultes. Après tout, disaient-ils, mieux valait que les gens s’en prennent à des andros qu’à de vraies femmes, non ?
Johnny Wu était plutôt d’accord. En tant que flic, il voyait son lot de femmes battues, souvent par leur compagnon, de cadavres de femmes battues aussi, avec le mari ou le mec qui pleuraient à chaudes larmes en disant qu’il ne comprenait pas, qu’il l’aimait et n’avait pas voulu cela. Elle l’avait énervé, disait-il, c’était sa faute aussi de le provoquer par une nouvelle dispute, par une remarque, par un simple geste. Elle savait qu’il était colérique. Elle était responsable. C’était de sa faute si elle était morte.
Johnny Wu dégagea doucement le visage encore intact de l’andro des longs cheveux bruns si soyeux qu’ils semblaient véritablement humains. Elle avait encore les yeux ouverts. Johnny se recula brusquement, et se détourna pour vomir, plié en deux.
— Qu’est-ce qui t’arrive ? demanda Julie en scannant le corps, cherchant le code-barre qu’elle ne trouvait pas.
— Son visage ! haleta Wu entre deux hoquets. Regarde son visage !
Julie obéit et se recula, une main sur la bouche.
— Oh, merde !
L’andro ressemblait comme deux gouttes d’eau à la sœur de Wu, Mimi. Elle avait le même visage en forme de cœur, de grands yeux et une petite bouche comme une cerise.
Wu finit de se vider et se redressa, s’essuyant la bouche d’un revers de main.
— Ce n’est pas normal, dit-il. Une andro ne peut pas ressembler comme ça à un être humain. Pas à ma sœur. Elle a le même grain de beauté sur le front. Ce n’est pas normal.
Julie lui posa une main sur l’épaule.
— Il y a surement une explication. Je vais m’occuper du corps. Rentre, si tu veux. Je rédigerai le rapport.
Mais Wu secoua la tête.
— Non ! Je veux savoir d’où elle sort.
— Je n’arrive pas à trouver son code-barre.
Ils se regardèrent. Une andro sortie d’une fabrique clandestine, c’était encore une autre histoire. Ça voulait dire une enquête administrative pour savoir qui fabriquait hors licence. AndrosCorp avait le monopole non seulement pour tout le pays, mais pour toute la planète, et ils ne rigolaient pas avec ça.
— Je vais l’emballer, dit Julie. On va la ramener au labo et on demandera à Chang de l’examiner.
— Je vais t’aider, marmonna Wu.
Avec délicatesse, ils mirent le corps brisé de l’andro dans un sac mortuaire et la chargèrent à l’arrière de leur voiture de patrouille, que Julie pilota jusqu’au toit de la tour du commissariat. Elle s’y posa en douceur et laissa Wu porter la forme inerte jusqu’à l’ascenseur. Durant le trajet, son collègue avait appelé sa sœur et il avait eu l’air rassuré de lui parler. Comme s’il avait douté un instant qu’elle fut bien vivante, et non pas à l’intérieur du sac mortuaire. Mimi avait fait une tentative de suicide deux ans auparavant, lorsqu’elle avait perdu l’enfant qu’elle portait et apprit qu’elle ne pourrait jamais en avoir. Depuis, Wu était passé de grand frère protecteur à grand frère constamment inquiet.
Wu ne perdit pas de temps en paperasse. Il porta directement le corps de l’andro au labo de la scientifique, à mi-hauteur de la tour, et demanda à Chang, le technicien, de procéder immédiatement à l’analyse. Le jeune scientifique le regarda d’un air amusé.
— J’ai vingt-sept affaires que je devais terminer la semaine dernière, dit-il soufflant sur le café qu’il venait de se servir. Dis-moi pourquoi je dois tout laisser tomber pour ce tas de ferraille.
— Parce qu’elle ressemble trop à ma sœur pour que ce soit une coïncidence, dit Wu en ouvrant le sac. S’il te plait, Chang, j’ai un mauvais pressentiment.
Chang regarda Wu et Julie Chow, comprit que c’était important pour le lieutenant avec qui il allait souvent boire un verre après le travail. Les deux hommes étaient devenus amis depuis dix ans qu’ils travaillaient ensemble.
— Bon, je vais y jeter un coup d’œil, mais pas plus d’une heure.
Il ouvrit le sac et grimaça à la vue de l’andro.
— Elle a morflé. Les sadiques qui font ça, moi je dis qu’il faudrait les obliger à voir un psy, en prévention. Cogner sur une andro n’est pas anodin.
Il dégagea le beau visage si semblable à celui de Mimi et ses traits de crispèrent. La ressemblance était troublante.
Chang scanna soigneusement le corps de l’andro et ne trouva pas plus de code-barre que Julie. Il énuméra rapidement les sévices qu’avait subis l’andro et les poings de Wu se serrèrent. L’andro avait morflé, comme avait dit Chang.
— Le malade qui a fait ça l’a cognée si fort dans le torse qu’il a réussi à briser les côtes en polymère, qui ont endommagé les circuits du fluide de transmission. D’où court-circuit général, la peau a cramé et le type l’a jetée avant d’avoir pu s’en prendre à son visage.
— Je veux savoir pourquoi elle est une copie de Mimi jusqu’à son grain de beauté, gronda Wu.
Chang fit plusieurs prélèvements et scanners et entra le total dans l’ordinateur, qui produisit le code génétique ayant servi comme modèle pour les traits de l’androïde et certaines indications techniques sur la provenance des pièces détachées, comme le squelette en polymère et la peau synthétique. Vendre son code génétique était autorisé, ça permettait de se faire de l’argent, comme des royalties, chaque fois qu’un andro sortait de la chaine de montage d’AndrosCorp avec votre corps et votre visage. Vendre le code génétique d’autrui, ou même d’une personne décédée, était interdit. Naturellement, il y avait tout un marché parallèle à ce niveau. Le top du top était d’arrivée à se procurer un échantillon de salive d’une star du grand ou du petit écran et de le vendre pour des prix dépassant le milliard de yuans à un labo clandestin qui vous produisait une copie certifiée conforme de votre acteur ou actrice préférée.
Les stars devenaient paranoïaques et ne laissaient plus rien trainer ni cheveux ni serviettes de restaurant tâchées de leur salive. Elles s’entouraient de gardes du corps dont le job était de veiller à ce qu’elles ne laissent aucune trace exploitable.
Wu savait que Mimi n’avait pas vendu son ADN, du moins, il l’espérait. Lorsque Chang sortit le code génétique qui avait servi de modèle pour l’andro, Wu signa une autorisation en tant que flic et frère pour faire une comparaison avec celui de sa sœur. Ce n’était pas très légal, vu que Mimi n’avait pas disparu et que personne n’avait porté plainte, mais Chang fit tout comme. Cette infraction était une goutte d’eau au milieu de la corruption qui régnait à l’échelle nationale.
Ils eurent la confirmation que c’était bien le code génétique de Mimi. Il n’y avait aucune autre trace d’ADN. Celui qui l’avait tabassé devait porter une combinaison de protection.
Quelqu’un avait vendu son ADN pour créer une andro à son image et lui faire subir les pires sévices.
Wu allait trouver ce salopard et lui faire payer.
—À voir la façon dont c’est monté, et le soft qui gère le total, je te suggère d’aller voir à Kowloon, un type nommé Doc. Je te note ses coordonnées. Ce n’est pas un méchant, juste un type qui s’est viré d’AndrosCorp parce qu’il est accro au metaspeed, mais fais quand même gaffe.
Wu le remercia, lui promit qu’il lui revaudrait ça et refusa que Julie l’accompagne. Il pouvait y avoir de la casse et il ne voulait pas entrainer sa coéquipière dans une histoire familiale. Julie le laissa partir. Elle se doutait que Wu n’allait pas uniquement appréhender le type qui avait volé l’ADN de Mimi et l’amener gentiment au poste. Il allait lui expliquer la vie, avant. Julie approuvait.
— Je peux faire quelque chose pour toi, partenaire ? demanda-t-elle.
— Va voir Mimi. Ne l’inquiète pas, ne lui dis rien, fais juste comme si tu passais dans le quartier.
Julie soupira. Elle n’allait pas du tout avoir l’air étrange à se pointer comme ça chez Mimi, en mode « prenons le thé », mais si ça pouvait aider Wu à se sentir un peu plus serein, elle le ferait. Elle voyait que son partenaire accusait salement le choc. Voir le doppelgänger de votre petite sœur adorée dans cet état avait ce genre d’effet.
Julie acheta des pâtisseries françaises sur le chemin, après avoir contacté Mimi pour lui demander si elle était disponible pour un petit moment. La jeune femme avait accepté, tout de suite inquiète pour son grand frère. Elle attendait Julie à son appartement, d’où elle travaillait en tant que journaliste free-lance pour un grand magazine scientifique international.
Après les politesses d’usage et la dégustation des pâtisseries accompagnées de thé noir préparé par Mimi, la conversation devint plus sérieuse. La jeune femme semblait penser que son frère avait des soucis, et Julie resta vague sur le sujet.
— Il est préoccupé, dit-elle finalement. Nous travaillons sur une affaire d’andro fabriqué avec de l’ADN illégal.
Elle regarda le visage de Mimi mais celle-ci ne cilla pas, démentant l’une des hypothèses de Julie. Le lieutenant s’était demandé si Mimi n’avait pas vendu son ADN pour faire face à des difficultés financières. Elle ne serait pas la première à le faire.
— Je n’aime pas ces nouveaux andros, dit Mimi en resservant du thé. Pourquoi ne pas créer des andros avec des visages nouveaux, qui n’appartiennent à personne ?
— Parce que les gens qui s’en servent veulent de l’authentique.
— Je trouve cela malsain.
Mimi fut interrompue par le retour de son mari, qui travaillait à la rédaction d’un quotidien d’information. Julie détourna pudiquement les yeux tandis que les deux époux échangeaient un léger baiser sur les lèvres. Elle enviait secrètement leur amour fusionnel. Mimi avait eu la chance de rencontrer l’amour fou en la personne de Louis Wong. Le jeune homme, qui avait trois ans de plus que Mimi, était grand et musclé, et bel homme avec ça. Julie se dit fugitivement qu’elle n’aurait rien eu contre le fait d’avoir un andro à l’image de Louis Wong qui l’attende dans son petit appartement de célibataire.
— Tu t’es blessé ? demanda soudain Mimi en voyant la main bandée de son mari.
— Je me suis renversé du thé brûlant sur la main, répondit Louis. Rien de grave.
Il accepta de prendre un peu de thé avec les deux femmes, et tous trois se lancèrent dans une conversation plaisante. Louis était trop bien élevé pour demander pourquoi Julie était là. Il s’était simplement contenté de s’enquérir de la santé de son beau-frère. Julie et lui avaient échangé un regard entendu. La jeune femme n’était pas là pour annoncer une mauvaise nouvelle, tout allait donc bien.
Le repaire de Doc était un ancien entrepôt à l’aspect peu engageant, mais dont l’intérieur faisait mal aux yeux tellement il rutilait. Les murs étaient couverts d’étagères sur lesquelles étaient soigneusement rangés des pièces d’andros, des squelettes entiers ou juste un membre, des torses en polymères, des poches de sang artificiel et des flacons de liquide bleu qui permettait aux nanomachines de circuler au cœur des machines. Doc lui-même présentait plutôt bien, ne serait-ce sa manie de se frotter le nez, signe que sa dernière dose de metaspeed remontait à trop longtemps. Il devait tout juste avoir passé la trentaine.
— J’ai déjà payé mon obole, dit-il d’un ton ennuyé à Wu. Allez voir avec vos collègues du district.
Doc payait les flics pour qu’ils ferment les yeux sur son petit commerce illégal. Rien de nouveau dans la nuit de Hong-Kong. Wu stoppa les protestations de Doc d’un geste. Il brandit son téléphone et fit jaillir dans l’air une représentation 3D du visage de l’andro.
— Il parait que c’est ton boulot, dit-il.
— Je ne suis pas au courant.
Le poing de Wu le cueillit droit à l’estomac et Doc se mit à tousser, plier en deux, en jurant qu’il payait sa protection et que Wu allait le regretter. Il finit par se redresser et lança un regard mauvais au flic qui venait lui pourrir sa soirée avec ses questions.
— Je me fous de ton business, gronda Wu. Je veux le nom de l’acheteur de ce modèle. Tu me le donnes et je repars comme je suis venu, gentiment.
— Comment voulez-vous que je me rappelle ? fit Doc en haussant les épaules. Vous avez vu le nombre que j’ai ?
Il désigna tout un mur où des visages d’andro, les yeux fermés, attendaient d’être coulés sur des corps artificiels.
— Celui-ci est un corps complet, dit Wu en montrant une photo du corps tabassé de l’andro. Fait avec de l’ADN illégal. Je veux savoir qui l’a acheté. Maintenant.
Ses dents serrées lui donnaient une voix grondante. Doc soupira, attrapa l’image 3D et la projeta vers son propre ordinateur où des colonnes de noms se mirent à défiler.
— Je vais appeler vos collègues, dit-il. Je paie une protection.
— Appelle le Grand Timonier si tu veux, dit Wu. Donne-moi le nom de l’acheteur.
— Louis Wong.
Ce fut Mimi qui lui ouvrit, toute souriante. Elle fut surprise par l’étreinte d’ours de son frère, et encore plus lorsque celui-ci alla droit vers son mari et lui dit qu’il était en état d’arrestation. Louis Wong se leva et se retrouva menotté avant d’avoir eu le temps de dire un mot.
— Mais tu es complètement cinglé ! cria Mimi. Laisse-le !
— C’est lui l’acheteur de l’andro ? demanda Julie, un air de dégout sur le visage.
— Oui.
— Mais qu’est-ce j’ai fait ? demanda Louis, qui était le seul à garder son calme au milieu de Wu qui semblait sur le point de le frapper et Mimi au bord des larmes.
Wu lui envoya son poing en pleine figure, ce qui n’était pas très fair-play vu que Wong était menotté, mais qui lui fit du bien.
— Je t’arrête pour avoir vendu l’ADN de ma sœur à ce type, Doc, et lui avoir acheté un andro à son image. Je t’arrête pour avoir tellement cogné cet andro que tu lui as brisé les côtes en putain de polymère. Je t’arrête pour avoir flanqué l’andro au milieu des poubelles au lieu de le porter au recyclage !
Wong ne baissa pas la tête en signe de culpabilité. Il saignait du nez, mais son regard était droit. Il regardait Mimi.
— Arrête ! hurla celle-ci à son frère. Détache-le ! Il n’a rien fait !
— Il s’est servi d’un andro à ton image pour te tuer ! s’écria Wu. C’est un psycho !
— Non ! cria Mimi. Ce n’est pas lui ! C’est moi !
Mimi était malade. Depuis qu’elle avait perdu le bébé, elle était suivie par un psy. Elle avait d’abord voulu mourir et s’était tranché les veines. Louis l’avait trouvée juste à temps. Mais elle avait continué à se faire du mal. Elle se coupait le ventre avec des lames de cutter, mutilant son corps qui ne voulait pas lui permettre d’être mère. Elle releva son pull et montra les cicatrices qui sillonnaient son ventre désespérément plat.
— J’ai pris des médicaments, mais ça m’a abrutie et je ne pouvais plus travailler, expliqua-t-elle. Alors mon psy a eu une idée : faire à un andro qui me ressemblerait ce que je me faisais. Comme ce n’est pas légal, j’ai donné un échantillon de salive à Louis qui connait Doc. L’autre soir, j’ai fait une crise. Ça m’arrive encore. J’ai cogné sur cette salope jusqu’à ce que toute ma rage soit en elle. Je l’ai cassée.
Mimi se frotta la main droite. Elle avait failli se brûler lorsque le torse de l’andro s’était ouvert et que les circuits avaient cramé. Lorsqu’elle s’était calmée, elle avait connu la honte habituelle de s’être laissée aller. L’andro était hors d’usage, elle l’avait chargé dans sa voiture volante et était allée la déposer loin, en pensant que les éboueurs l’embarqueraient avec le reste des sacs-poubelle contenant les déchets non recyclables.
— Je n’avais pas la force de la conduire au recyclage, dit-elle. Et je ne pouvais pas allez chez Doc. J’ai trop honte. Il croit que Louis se sert de l’andro pour s’amuser.
Wu détacha lentement Louis, qui le repoussa pour aller prendre Mimi dans ses bras. La jeune femme se mit à sangloter.
— Je suis désolé, dit Wu. Je ne savais pas.
— Tu ne pouvais pas savoir, dit Louis en caressant les cheveux soyeux de Mimi.
Wu et Julie partirent, parce qu’ils ne pouvaient rien faire d’autre que de laisser Louis aider Mimi à panser sa plaie béante de ne pouvoir être mère. Dans le portable de Wu, il y avait la liste des acheteurs de Doc, qu’il avait piratée pendant que celui-ci la consultait. Mimi se servait de son andro à des fins thérapeutiques, mais elle était l’exception qui confirme la règle. Les autres acheteurs seraient désormais les devoirs du soir du lieutenant Wu. Il surveillerait discrètement ces psychos, et s’assureraient qu’aucun d’eux n’était un danger pour l’humain dont il avait volé l’ADN.
Louis Wong remonta doucement la couverture sur le corps endormi de Mimi. Sa femme avait sombré dans un profond sommeil et il avait toute la soirée devant lui. Il descendit au garage qu’il louait dans les sous-sols de l’immeuble et veilla à ce que personne ne le voit entrer. Officiellement, la grande pièce servait de cave pour des vieilles affaires venant de ses parents décédés. Mimi n’y descendait jamais et de toute façon, elle n’avait pas le code d’accès.
Louis alluma et aussitôt, un andro à l’image de Mimi, vêtue d’une élégante robe de soirée, s’anima et vint l’embrasser.
— Tu m’as manqué, ma chérie, dit-il en l’enlaçant. Ta sœur a fait une nouvelle crise.
— Je suis désolée, dit l’andro. Que puis-je faire pour te rendre heureux, mon amour ?
— Le simple fait que tu existes me rend heureux, Mimi. Un jour, tu sais que toi et moi vivrons en haut, dans l’appartement. Il faut juste attendre un peu. Ta sœur ne va pas bien. Quand elle mourra, nous pourrons être ensemble.
Si vous aimez la plume de Chris, vous pouvez retrouver 3 autres de ses nouvelles dans le recueil Villes étranges aux éditions du 38 dans toutes les bonne libraires et en numérique.