Phrase donnée par Aloyse Blackline
Du pire, comme du meilleur, voila dont ce que l’on était tous capable de faire.
J’avais vu mon ami mille fois tirer sur les soldats ennemis. Cent fois les transpercer avec sa baïonnette. Quelques fois devoir en tuer à mains nues. Avec son passé de bûcheron, sa force surhumaine et ses mains en comme des pattes d’ours, il était clair qu’au corps-à-corps, il ne craignait pas grand choses. Même à distance, à vrai dire, on aurait dit que sa peau d’homme de la forêt faisait ricocher les balles.
Je ne savais pas par quel miracle moi j’étais encore en vie, peut-être parce qu’il me l’avait sauvé un bon nombre de fois. Je ne sais pas. L’inverse devait aussi être vrai.
Toujours est-il qu’il m’avait toujours semblé être de ces grands gaillards, capable de fracasser le crâne d’un taureau d’un simple coup de poing, et pourtant gentil et coopératif, docile presque, et d’un calme olympien, mais qui pouvait se transformer en monstre sanguinaire une fois toute sa patience, et Dieu sait qu’il en avait, épuisée.
Dans la boue des tranchées, nous étions là depuis si longtemps que nous ne nous souvenions même pas avoir vécu autre chose, juste des images à peine moins fugaces dans nos mémoires que les rêves que nous faisions les rares fois où nous arrivions à dormir.
Avec les problèmes de ravitaillement, plus aucun de nous ne pouvait se raser, même nos couteaux ne coupaient plus, ce qui posait de grave problème pour l’utilisation des masques à gaz. Les poils sur nos visages empêchaient les dispositifs d’être complétement étanches et beaucoup d’entre nous étaient morts à cause de ça.
Si au moins nos généraux avaient réussi à nous fournir des rasoirs, ça aurait épargné beaucoup de vies. Quel gâchis !
Mon ami, avec sa barbe, ressemblait à un cosaque, ou au moins à l’idée que je m’en faisais. Et le masque sur le visage, il ressemblait à un démon du premier cercle venu sur Terre pour tous nous emmener avec lui. Il ne manquait plus que les cornes. Plusieurs fois, le simple fait de le voir bondir hors des tranchées et monter à l’assaut en hurlant de toutes ses forces, avait suffi à faire reculer les lignes ennemies. Alors que moi, à moitié attaqué à par les gaz neurotoxiques, j’avais, la plupart du temps, l’impression étrange de ne plus commander mon corps, juste de le voir de loin, en simple spectateur, avancer vers l’ennemi, à l’abri de mon ami.
La dernière fois que c’est arrivé, il faisait gris, sombre, froid. J’avais l’impression que le ciel n’avait jamais été autre chose que cette couche épaisse de nuage prête à déverser de la pluie ou de la neige. Le sol était un amas étrange entre la boue et la terre gelée sculptée de la trace de nos pas nombreux.
Cette fois-là, le capitaine, qui semblait encore plus usé que nous mais tentait de faire bonne figure, nous avait donné l’ordre de monter à l’assaut pour prendre la tranchée en face de nous, encore. À trente mètres de là, tout au plus. Cela faisait des semaines que nous jouions au chat et à la souris, si je puis dire, à la prendre et la perdre, jusqu’à plusieurs fois par jour. Au prix de combien de vies ?
Comme chaque fois, l’ordre était clair. Il fallait la reprendre et la garder.
Du renfort nous était arrivé à l’aube, des vieillards pour la plupart, la majeure partie des jeunes gens étant sur le front, ou déjà morts. Si nous n’étions pas arrivés à garder cette tranchée avec les forces vives de la Nation, comment le pourrions-nous avec les forces vives de la précédente république ?
L’assaut avait été donné à sept heures du matin, il faisait encore nuit. En plus du nouvel arrivage de ces futurs morts, nous avions l’appui d’une nouvelle unité d’artillerie. J’espérais qu’elle viserait mieux que la précédente qui avait décimé la moitié de la compagnie lors d’un assaut.
Quand nous sommes sortis, les balles ont commencé à fuser. Les autres n’étaient pas fous et se doutaient bien que ce jour-là encore, nous tenterions de gagner du terrain. Ils nous attendaient bien sagement.
Je ne sais plus vraiment comment ni combien d’entre nous sommes arrivés jusqu’à la tranchée, à travers les fumerolles de gaz toxiques et les explosions de notre artillerie, qui, il fallait l’avouer, se débrouillait assez bien, cette fois.
Une fois dans les lignes adverses, ça a encore une fois été le carnage. Mon ami et moi étions côte à côte, à essayer de survivre, transperçant tout ce qui se présentait à nous. Nous ne regardions même plus les uniformes. Des fois, je me demande si je n’ai pas tué des camarades ce jour-là.
Au bout d’un temps incommensurable, il ne restait plus que mon ami et moi. Et un soldat ennemi. Un gamin. Je ne sais même pas s’il avait dix-sept ans.
Il était par terre. Le tenant en joue, mon camarade le regardait de toute sa hauteur, à travers les carreaux de son masque. Il l’arracha rapidement, ne voulant pas de filtre pour voir se gamin mourir. Ils se regardèrent un moment.
Un long moment.
Et moi aussi, je regardais. C’était comme si le temps s’était arrêté. Et les explosions. Le vacarme. Tout.
Le gamin était paralysé. Qui ne l’aurait pas été, allongé sur le sol, un fusil le pointant à moins d’un mètre ?
Ça se voyait dans son regard qu’il ne savait même pas pourquoi il était là. Est-ce que nous le savions plus que lui ?
Et au bout d’un temps interminable, mon ami a baissé son arme, souri et tendu la main au gamin pour l’aider à le relever.
Le garçon, d’abord, n’a pas bougé. Il ne savait pas comment réagir. Puis finalement, il a attrapé la patte d’ours avant d’être littéralement arraché du sol pour atterrir sur ses pieds.
Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Il a fait un mouvement rapide. Maintenant que j’y pense, c’était peut-être juste par manque d’équilibre. J’ai eu peur pour mon ami, et avant même que ma conscience ne s’en rende compte, mes muscles avaient déjà agi. Ou peut-être que mon masque n’avait pas réussi à me protéger des gaz cette fois-ci. C’est ce que je me dis de temps en temps pour pouvoir me regarder dans le miroir.
Ce ne furent pas les yeux du gamin qui me choquèrent mais ceux de mon camarade. Il me regarda comme le pire des monstres et avec l’envie visible de me tuer. Je ne sais pas ce qui le retint alors. Et des fois, je regrette qu’il ne m’ait pas envoyé là où je venais d’expédier le gamin avec ce coup de baïonnette.
Du pire, comme du meilleur, voila dont ce que l’on était tous capable de faire. Mais ce jour-là, alors qu’il venait de faire ce qu’on pouvait faire de mieux dans ces cimetières de la guerre, moi, j’ai fait ce qu’il y avait de pire.
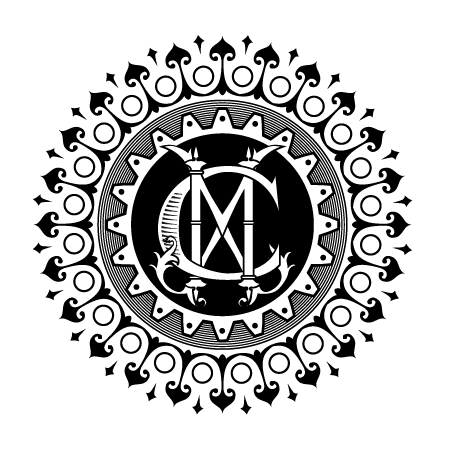
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.